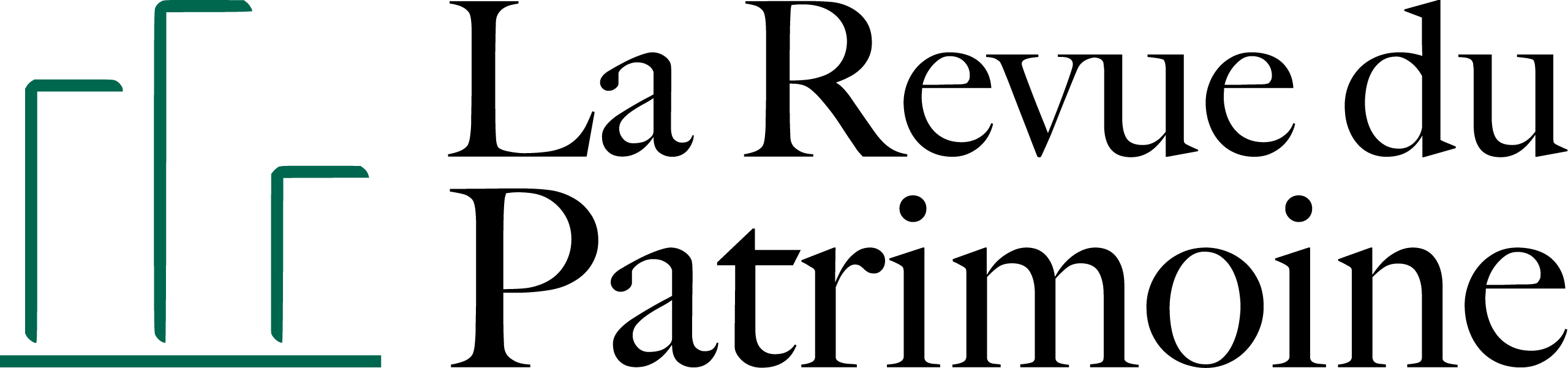Depuis 2015, la France a enregistré 4 675 opérations de LBO, un record absolu en Europe.
4 675 LBO en France depuis 2015 : faut-il s’inquiéter ?
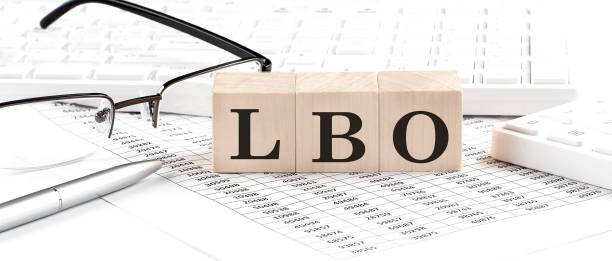
Ce chiffre place notre pays loin devant l’Allemagne et l’Italie, et illustre l’essor spectaculaire du rachat d’entreprise par effet de levier. Rien qu’en 2018, le LBO représentait 65 % du capital-investissement en France, avec plus de 9,5 milliards d’euros injectés. Sur le papier, cette mécanique financière promet une rentabilité élevée et une croissance rapide. Mais dans les faits, elle expose de nombreuses entreprises à une fragilité structurelle face aux crises économiques et aux hausses de taux d’intérêt.
Le désastre social du capital-investissement mal encadré
Le LBO repose sur un principe simple : l’entreprise rachetée s’endette pour financer son propre rachat. Tant que les résultats suivent, le système fonctionne. Mais dès que la conjoncture se retourne, ce sont souvent les salariés, les fournisseurs et les territoires qui en subissent les conséquences.
Le cas de Vivarte est emblématique : plusieurs LBO successifs ont généré une dette de près de 2,8 milliards d’euros, précipitant la chute du groupe (La Halle, André, Naf Naf…). Résultat : des fermetures massives, des milliers d’emplois supprimés, et un groupe placé sous contrôle de créanciers financiers.
Même logique pour Maisons Phénix, ex-filiale de Geoxia, liquidée en 2022. Plus de 1 000 salariés licenciés, 1 600 chantiers stoppés net, et une filière entière déstabilisée.
En 2023, c’est Vertbaudet qui a fait la une avec 75 jours de grève, dénonçant une gestion centrée sur les profits des fonds, au détriment des conditions de travail. Des appels au boycott ont été lancés. C’est tout un symbole de l’écart entre la rentabilité affichée et la souffrance sociale provoquée par certaines stratégies de private equity.
Un modèle à repenser pour un LBO responsable
Pourquoi la France est-elle devenue le terrain de jeu favori des fonds d’investissement ? Plusieurs facteurs se cumulent : un cadre fiscal favorable à la dette, un tissu économique très fragmenté (avec beaucoup de PME familiales en quête de succession), et une liquidité abondante depuis 2008.
Mais un autre élément clé aggrave le phénomène : la réforme de 2021 sur les procédures collectives, qui a renforcé le pouvoir des créanciers au détriment des actionnaires et salariés. Elle permet désormais à des fonds de dette étrangers de prendre le contrôle d’entreprises françaises, simplement en convertissant leurs créances en capital. Un déséquilibre juridique majeur.
Il est donc temps de repenser ce modèle en profondeur. Pour un LBO durable, il faut :
Limiter l’endettement selon la taille et la solidité de l’entreprise (par exemple via un ratio dette/EBITDA plafonné)
Imposer des clauses sociales et territoriales contraignantes, avec des engagements chiffrés sur l’emploi
Rééquilibrer le pouvoir entre créanciers et acteurs industriels de long terme
Et surtout, réformer la fiscalité pour ne plus privilégier systématiquement la dette sur les fonds propres
Certes, certains LBO bien structurés peuvent soutenir l’innovation ou la transmission d’entreprise. Mais cela reste l’exception. L’heure n’est plus à l’euphorie, mais à la régulation.
Conclusion
La France a fait du LBO une spécialité. Mais derrière les chiffres flatteurs, le modèle cache une réalité préoccupante : des entreprises surendettées, une dépendance aux marchés financiers, des emplois menacés. Ce système, pensé pour maximiser les rendements, ne peut plus ignorer ses impacts humains, sociaux et territoriaux.
Il est temps d’imposer un pacte de responsabilité autour du LBO, aligné sur les enjeux de résilience économique, d’emploi et de souveraineté industrielle. À l’heure des grandes transitions, notre patrimoine productif mérite mieux qu’un simple effet de levier.