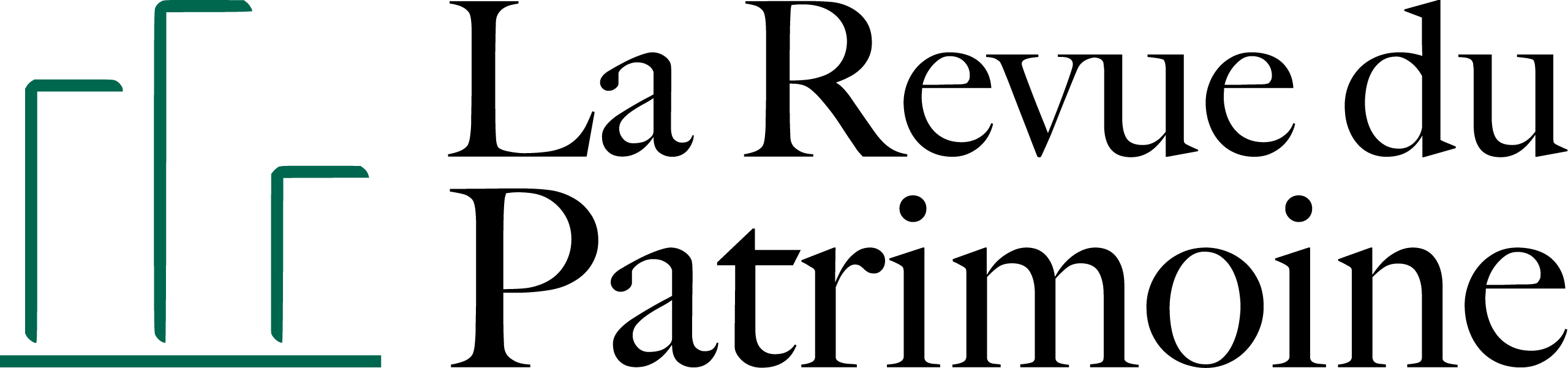Plus de dix ans après le lancement de l’union bancaire européenne, le constat est amer : l’harmonisation des règles bancaires reste fragmentaire. Entre clarifications à répétition de la BCE, incertitudes juridiques et asymétrie entre établissements, ce chantier révèle les limites structurelles de l’ambition européenne. Il est temps de sortir du rafistolage permanent et de repenser en profondeur le cadre réglementaire.
Supervision bancaire européenne : un chantier toujours en cour

Plus de dix ans après sa création, la supervision bancaire européenne peine encore à établir des règles du jeu équitables. Les récentes clarifications de la BCE sur l’interprétation des réglementations bancaires européennes nous rappellent une vérité dérangeante : l’union bancaire reste un projet incomplet.
Un patchwork réglementaire révélateur
Quand la BCE a endossé le rôle de superviseur bancaire européen en novembre 2014, elle héritait d’un patchwork réglementaire où chaque pays avait développé ses propres pratiques. Onze ans plus tard, force est de constater que l’harmonisation se fait encore au cas par cas, document par document, comme en témoigne cette énième mise à jour de la doctrine européenne publiée vendredi dernier.
Cette approche fragmentaire pose une question fondamentale : comment peut-on prétendre avoir une véritable union bancaire quand les règles restent si floues qu’elles nécessitent des clarifications constantes ? Le fait que seules 13 associations bancaires et deux banques aient répondu à la consultation publique de novembre dernier révèle peut-être un certain désintérêt du secteur pour ces exercices de précision réglementaire devenus routine.
L’exemple du fameux « compromis danois » est particulièrement révélateur des dysfonctionnements du système actuel. Ce dispositif, censé favoriser le modèle de bancassurance, illustre parfaitement la complexité réglementaire de nos systèmes bancaires. Que les établissements doivent désormais attendre une clarification de la BCE pour savoir s’ils peuvent intégrer leurs dettes AT1 et Tier 2 dans leurs calculs de solvabilité montre à quel point nos textes manquent de clarté.
Plus grave encore : les récents refus opposés à Banco BPM et BNP Paribas pour leurs acquisitions via leurs filiales assurantielles créent une « jurisprudence » par défaut. C’est reconnaître implicitement que nos règles sont si imprécises qu’elles s’établissent au gré des décisions ponctuelles du superviseur bancaire. Où est la sécurité juridique ? Où est la prévisibilité promise aux acteurs du marché ?
Une asymétrie réglementaire dommageable
La BCE ajuste sa doctrine après consultation, ce qui peut sembler vertueux. Mais cette approche révèle en réalité une faiblesse structurelle : nos législateurs européens produisent des textes si ambigus qu’ils nécessitent une interprétation constante de l’autorité de supervision. Les directives CRR3 et CRD6, dernières en date, confirment cette tendance inquiétante.
Cette situation crée une asymétrie réglementaire entre les acteurs du marché. Les grandes banques, avec leurs équipes juridiques étoffées, peuvent naviguer dans ce labyrinthe réglementaire et même influencer les consultations. Les établissements plus modestes subissent ces évolutions sans avoir les moyens de les anticiper ou de les contester.
L’urgence d’une refondation réglementaire
Il est temps de reconnaître que l’approche actuelle a atteint ses limites. Plutôt que de multiplier les clarifications a posteriori, l’Europe devrait avoir le courage de simplifier et d’unifier véritablement ses règles bancaires. Cela nécessite une révision en profondeur de notre cadre législatif, avec des textes européens plus précis dès leur adoption, une véritable harmonisation des pratiques nationales, et plus de transparence dans les processus de consultation pour associer plus largement les parties prenantes.
Dans un contexte de concurrence bancaire internationale accrue, l’Europe ne peut pas se permettre de handicaper ses banques avec un système aussi lourd et imprévisible. Nos établissements doivent pouvoir se concentrer sur leur métier plutôt que de consacrer des ressources croissantes à déchiffrer des règles en perpétuelle évolution.
L’union bancaire européenne était une belle ambition. Elle reste largement à construire. Les clarifications de la BCE, aussi nécessaires soient-elles dans l’immédiat, ne doivent pas nous faire oublier l’essentiel : il est temps de passer d’une logique de rafistolage réglementaire à une véritable refondation du cadre bancaire européen.
L’Europe mérite mieux qu’une union bancaire au rabais, construite à coups de notes techniques et de jurisprudences hasardeuses. Elle mérite des règles claires, équitables et stables, dignes de la première puissance économique mondiale.