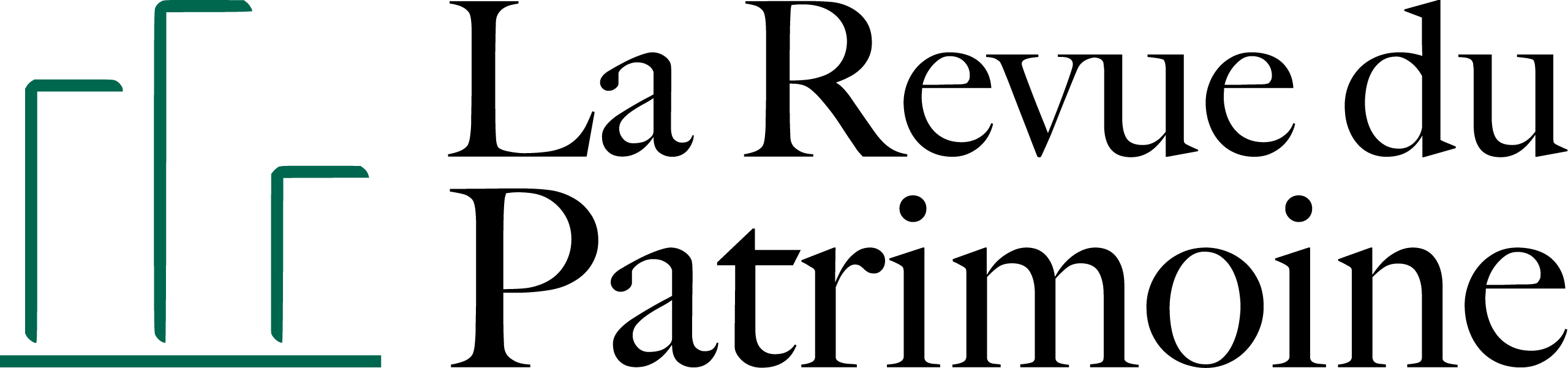Les blockchains publiques ne sont pas seulement une technologie, mais une vision d’avenir – celle d’un numérique transparent, souverain et décentralisé.
Blockchain et RGPD en Europe : à la recherche d’un équilibre vital

L’Europe qui a su créer le RGPD peut aussi inventer un cadre adapté qui protège les individus sans étouffer l’innovation. Notre avenir numérique ne se construira ni dans l’anarchie, ni dans une régulation aveugle, mais dans un équilibre intelligent préservant à la fois nos valeurs et notre indépendance technologique.
Le choc des cultures : RGPD vs Blockchain
Le RGPD, entré en vigueur en 2018, s’est imposé comme une référence mondiale en matière de protection des données. Il consacre des principes essentiels – consentement, minimisation des données, droit à l’effacement – difficilement conciliables avec les caractéristiques intrinsèques des blockchains publiques. L’immutabilité est au cœur de cette contradiction : par conception, les données inscrites sur une blockchain ne peuvent être modifiées ou supprimées. La transparence impose que toutes les transactions soient visibles et vérifiables par les participants. La décentralisation, enfin, complique considérablement l’identification d’un « responsable de traitement » au sens du RGPD.
Cette incompatibilité n’est pas nouvelle. Dès 2018, l’Assemblée nationale française publiait un rapport soulignant ces contradictions. La CNIL, dans son analyse de la même année, proposait déjà des solutions techniques comme le stockage « off-chain » pour les données sensibles. Mais les nouvelles lignes directrices du CEPD vont plus loin, considérant désormais explicitement que les blockchains publiques sont « non conformes par défaut« .
Un risque de désindustrialisation numérique européenne
Depuis l’adoption de MiCA (Markets in Crypto-Assets) en 2022, l’Europe s’était positionnée comme pionnière dans la régulation équilibrée des crypto-actifs. Cet effort risque aujourd’hui d’être réduit à néant si les infrastructures sous-jacentes deviennent juridiquement impossibles à opérer. L’European Crypto Initiative (EUCI), qui regroupe des acteurs majeurs comme Ledger (France) et Bitpanda (Autriche), alerte sur les conséquences économiques : migration des talents et investissements vers des juridictions plus favorables (Suisse, Singapour, Émirats), ralentissement de l’innovation dans des secteurs prometteurs comme la finance décentralisée et les identités numériques souveraines, et renforcement paradoxal des solutions centralisées, potentiellement plus risquées pour la vie privée.
Réconcilier innovation et droits fondamentaux
Le débat ne doit pas se réduire à une opposition binaire. Des innovations prometteuses émergent pour concilier protection des données et innovation blockchain. Les Zero-Knowledge Proofs, ces protocoles cryptographiques utilisés notamment par Aztec Network et Polygon Nightfall, permettent de valider des informations sans révéler les données sous-jacentes. La cryptographie homomorphe autorise des calculs sur des données chiffrées sans les déchiffrer. Les systèmes de stockage hybrides combinent astucieusement données « on-chain » (références, preuves) et « off-chain » (contenu effectif). Enfin, des mécanismes de gouvernance décentralisée permettent d’implémenter collectivement des décisions comme le droit à l’oubli.
Ces technologies, loin d’être théoriques, sont déjà implémentées dans plusieurs projets européens comme Concordium ou Alastria.
Vers un RGPD adapté… ou vers une recentralisation des infrastructures numériques ?
La consultation publique ouverte par le CEPD jusqu’au 30 juin 2025 représente une occasion décisive. Loin d’un simple ajustement technique, elle cristallise un choix stratégique pour l’Europe : poursuivre un modèle fondé sur la centralisation institutionnelle — comme le suggèrent le projet d’euro numérique ou le futur portefeuille d’identité numérique européen — ou reconnaître la décentralisation comme un levier légitime de protection des données et d’innovation.
Car en l’état, les lignes directrices du CEPD sur la blockchain semblent traduire une méfiance profonde vis-à-vis des architectures ouvertes et distribuées. Pourtant, des outils cryptographiques comme les Zero-Knowledge Proofs ou la gouvernance collective on-chain offrent déjà des garanties de confidentialité et de résilience que nombre de systèmes centralisés peinent à égaler.
Plutôt que de calquer le RGPD sur une vision technocratique du numérique — où chaque traitement serait contrôlé par une autorité désignée — l’Europe pourrait innover : créer une catégorie juridique pour les “responsables de traitement décentralisés”, intégrer les technologies de confidentialité native à sa doctrine réglementaire, et adopter une approche par les risques réels, à l’image des regulatory sandboxes déployés à Singapour. À défaut, elle risque de faire converger sa stratégie numérique vers un modèle de contrôle institutionnel centralisé, bien plus proche de la logique chinoise qu’elle ne veut l’admettre.
Défendons notre patrimoine décentralisé
Les blockchains publiques représentent plus qu’une simple technologie : elles incarnent une vision du numérique fondée sur la transparence, la décentralisation et l’autonomie des utilisateurs. Elles constituent, à ce titre, un patrimoine intellectuel et technologique que l’Europe aurait tort d’étouffer sous le poids d’une réglementation inadaptée. Comme l’avait justement souligné la Commission européenne dans sa stratégie blockchain de 2021 : « L’Europe doit saisir cette opportunité pour renforcer sa position dans la course mondiale à l’innovation. »
La réponse ne peut être ni l’anarchie numérique, ni la régression technologique. Elle réside dans un dialogue constructif entre régulateurs, innovateurs et utilisateurs pour créer un cadre qui protège les droits fondamentaux tout en permettant l’émergence d’architectures numériques plus résilientes, plus transparentes et plus respectueuses de l’autonomie individuelle.
L’Europe a su, avec le RGPD, définir un standard mondial pour la protection des données. Elle peut désormais montrer la voie d’une régulation intelligente de la blockchain, qui préserve ses principes sans sacrifier le potentiel d’innovation qu’elle représente.